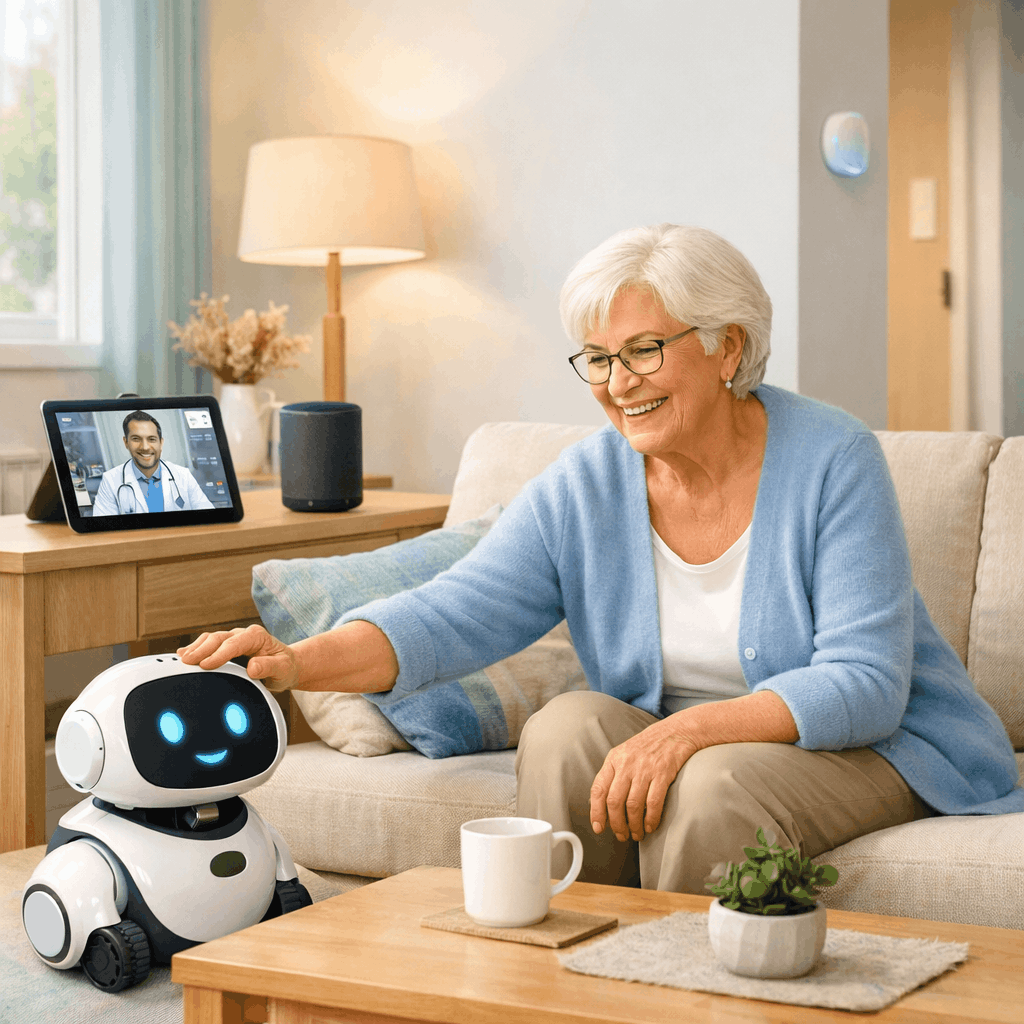Depuis le 1ᵉʳ décembre 2025, une réforme majeure est entrée en vigueur en France pour simplifier la prise en charge des fauteuils roulants indispensable à la mobilité des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Cette transformation, portée par l’État et officialisée par des textes législatifs, marque un tournant important en matière d’accessibilité, d’autonomie et d’équité. Elle garantit désormais que tout fauteuil roulant prescrit par un professionnel de santé soit remboursé intégralement par l’Assurance maladie, sans reste à charge pour l’utilisateur ou sa famille.
Dans cet article, on vous explique en détails ce qui change, comment cela fonctionne, qui est concerné et quelles démarches entreprendre pour en bénéficier — que vous soyez une personne concernée, un aidant ou un proche de personne âgée, ou encore un professionnel de santé.
Une réforme historique pour l’accès à la mobilité
Pendant longtemps, le remboursement des fauteuils roulants en France était partiel et complexe : il dépendait de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la complémentaire santé, de financements départementaux ou d’aides diverses. Cela impliquait souvent des démarches longues, des restes à charge importants et une multitude d’interlocuteurs.
Avec la réforme mise en place à partir du 1ᵉʳ décembre 2025, l’Assurance maladie devient le financeur unique et principal, garantissant un accès intégral à la mobilité via la prise en charge à 100 % de l’achat ou de la location de fauteuils roulants répondant à certains critères.
Cette mesure fait suite à des engagements pris lors de la Conférence nationale du handicap en 2023 et a été officialisée par des arrêtés et textes publics, avec pour objectif de garantir un droit effectif à la mobilité pour tous les citoyens concernés.
Qui est concerné par la prise en charge à 100 % ?
Cette réforme s’adresse principalement à :
- toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit l’âge ;
- les personnes âgées en perte de mobilité ou d’autonomie ;
- les personnes ayant besoin d’un fauteuil roulant après un accident ou en cours de réadaptation.
Le remboursement intégral est possible dès lors que le fauteuil est prescrit par un professionnel de santé compétent (médecin, ergothérapeute ou autre spécialiste habilité) et qu’il répond à un besoin réel et légitime de compensation du handicap.
Cette prise en charge s’applique aussi bien à l’achat qu’à la location longue durée ou à la location courte durée, selon les besoins de mobilité et les prescriptions techniques.
Quels types de fauteuils sont pris en charge ?
L’un des aspects les plus inclusifs de cette réforme est son champ d’application étendu. Sont désormais couverts à 100 % :
- les fauteuils roulants manuels classiques ;
- les fauteuils roulants électriques, y compris les modèles modulaires ou spécialisés ;
- les fauteuils dédiés à la pratique sportive ou adaptés à des besoins particuliers.
Même les options ou adjonctions spécifiques (améliorations ou fonctionnalités précises qui ne font pas partie de la liste standard) peuvent être prises en charge, à condition de faire l’objet d’une demande d’accord préalable auprès de l’Assurance maladie ou de la MSA. Si aucun refus n’est formulé dans un délai de deux mois, le silence vaut accord.
Cette évolution représente une avancée considérable, surtout pour des fauteuils jusque-là difficiles à financer — en particulier pour les versions électriques ou sportives, souvent très coûteuses.
Démarches : comment bénéficier de la prise en charge
Pour que la prise en charge intégrale soit effective, plusieurs étapes sont nécessaires :
1. Consultation médicale et prescription
La première étape consiste à consulter un professionnel de santé — médecin, ergothérapeute ou autre spécialiste — qui évaluera vos besoins.
Cette évaluation permet d’identifier le type de fauteuil le mieux adapté à votre situation et de justifier la prescription auprès de l’Assurance maladie ou de la MSA.
2. Choix et essai du matériel
Une fois la prescription obtenue, vous pouvez essayer plusieurs modèles de fauteuils auprès de prestataires ou de distributeurs agréés. Cela garantit que l’équipement est bien adapté à votre confort, votre posture et vos besoins quotidiens.
3. Dépôt de la demande à l’Assurance maladie
La demande de prise en charge se fait directement auprès de l’Assurance maladie (ou de la MSA si vous relevez de ce régime).
La procédure est désormais centralisée et simplifiée, évitant ainsi de devoir solliciter plusieurs organismes comme auparavant.
4. Réponse dans un délai contraint
Pour les options ou adjonctions spécifiques qui ne sont pas immédiatement incluses dans la liste standard, la procédure prévoit un délai de traitement maximal de 2 mois. Si aucune réponse n’est donnée à l’issue de ce délai, la demande est automatiquement acceptée.
Maintenance, réparation et suivi
Un autre avantage important de cette réforme est que l’entretien, la maintenance et la réparation du fauteuil roulant sont également pris en charge.
Pour les fauteuils roulants manuels et électriques, des forfaits annuels de réparation plus élevés ont été introduits, simplifiant encore l’usage à long terme de l’équipement et réduisant le fardeau financier pour l’utilisateur.
Ce que cette réforme change concrètement pour les usagers
Plus de reste à charge
L’un des bénéfices les plus marquants est la suppression du reste à charge pour l’utilisateur. Avant la réforme, des fauteuils — en particulier les modèles spécifiques ou sur mesure — pouvaient être très coûteux, parfois jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
Accès simplifié en un seul guichet
La réforme fait de l’Assurance maladie (ou de la MSA) le guichet unique pour toutes les demandes de remboursement de fauteuils roulants. Cela évite les démarches complexes auprès de multiples organismes et réduit largement les délais de traitement.
Choix du fauteuil adapté
Une autre avancée importante est le droit pour le bénéficiaire de choisir un fauteuil adapté à ses besoins spécifiques, même si ce modèle n’est pas celui généralement fourni par une structure d’accueil (comme un EHPAD). Les établissements ne peuvent plus imposer un fauteuil standard si une prescription justifie un modèle plus adapté.
Cas particulier : fauteuils en EHPAD
Pour les personnes âgées vivant en EHPAD ou en résidence autonomie, cette réforme est particulièrement significative. Jusqu’à présent, de nombreux établissements fournissaient des fauteuils standards qui ne convenaient pas toujours parfaitement aux besoins individuels des résidents, entraînant parfois un confort limité ou un manque d’autonomie.
Aujourd’hui, grâce à la prise en charge intégrale, tous les résidents peuvent obtenir un fauteuil personnel adapté à leurs besoins — qu’il soit manuel, électrique ou spécialisé — sans frais supplémentaires pour eux ou leurs familles.
Cette liberté de choix améliore directement le confort, la mobilité et la qualité de vie des personnes concernées, en leur offrant un équipement réellement adapté et non seulement fonctionnel.
Une réforme qui change la vie
La réforme de la prise en charge des fauteuils roulants entrée en vigueur le 1ᵉʳ décembre 2025 constitue une évolution majeure dans le système d’aide à la mobilité en France. Elle garantit un accès sans reste à charge, simplifie les démarches et offre une liberté de choix pour les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
En réunissant l’achat, la location et l’entretien sous un guichet unique, tout en élargissant la gamme de matériels couverts, cette mesure s’inscrit dans une logique de justice sociale, d’autonomie retrouvée et de confort pour les usagers — qu’ils vivent à domicile ou en établissement.
N’oubliez pas : pour obtenir ce remboursement intégral, une prescription médicale adaptée est indispensable. Parlez-en à votre médecin, ergothérapeute ou au médecin coordonnateur de votre établissement pour définir les meilleurs choix d’équipement possibles.