Face au vieillissement de la population, les besoins d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie se diversifient. Parmi les dispositifs existants, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) constitue une aide essentielle pour permettre aux seniors de continuer à vivre dans des conditions dignes et sécurisées. Moins connue du grand public, son articulation avec l’habitat partagé offre pourtant des perspectives très intéressantes. Explications.
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’habitat partagé : une alliance au service du bien vieillir
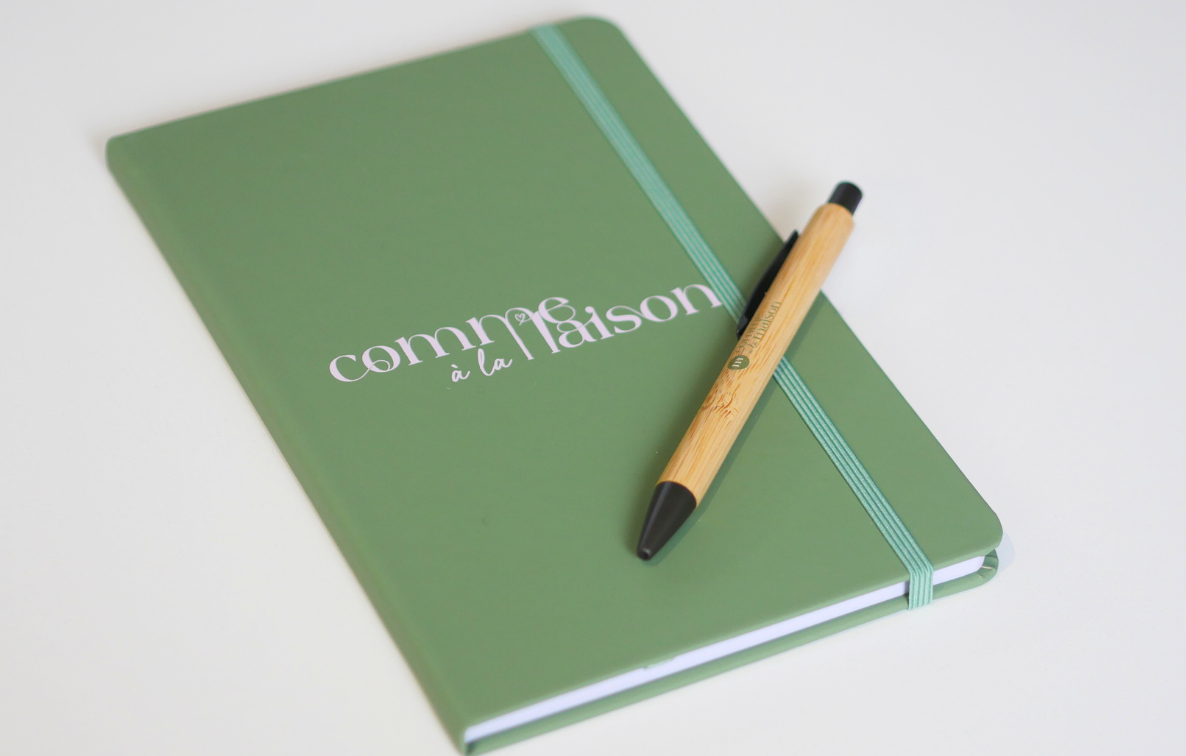
L’APA, une aide pour rester autonome
L’APA est une prestation sociale destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus qui rencontrent des difficultés pour accomplir seules certains actes de la vie quotidienne. Cette aide, versée par les conseils départementaux, est attribuée sans condition de ressources mais son montant varie selon le degré de perte d’autonomie (calculé via la grille AGGIR) et le niveau de revenus du bénéficiaire.
Deux formes principales existent
• l’APA à domicile, pour les personnes vivant chez elles ou dans un habitat non médicalisé ;
• l’APA en établissement, pour les résidents d’EHPAD.
Dans les deux cas, l’objectif est le même : financer les prestations nécessaires pour compenser la perte d’autonomie, qu’il s’agisse d’aide humaine (aide à domicile, auxiliaire de vie), d’aménagement du logement, de portage de repas, ou encore de transports adaptés.
Habitat partagé : une alternative entre domicile et EHPAD
L’habitat partagé s’impose progressivement comme une solution innovante pour les personnes âgées souhaitant éviter la solitude sans pour autant entrer en maison de retraite. Il s’agit d’un logement collectif à taille humaine, souvent limité à 5 ou 6 personnes, où chacun bénéficie d’un espace privatif tout en partageant des espaces communs et des temps de vie collectifs.
Ce type d’hébergement, non médicalisé, permet de créer une ambiance familiale, rassurante et personnalisée, tout en facilitant l’accès à des services d’accompagnement mutualisés. Il répond ainsi aux besoins de seniors en perte d’autonomie légère à modérée, qui souhaitent concilier vie sociale, soutien au quotidien et liberté de choix.
L’APA à domicile : un levier pour financer l’habitat partagé
L’un des grands atouts de l’APA est sa mobilité : elle suit la personne, quel que soit son lieu de vie. Ainsi, une personne âgée vivant en habitat partagé peut percevoir l’APA à domicile, tant que la structure accueillante ne dépasse pas le seuil de 25 places (au-delà, il s’agit d’un établissement, et l’APA versée change de forme).
Ce principe rend l’APA pleinement compatible avec l’habitat partagé, qui repose justement sur des formats à taille humaine. Le montant de l’APA à domicile est défini sur la base d’un plan d’aide personnalisé établi par l’équipe médico-sociale du département, en fonction des besoins de la personne.
Mutualiser les aides pour un accompagnement renforcé
Une spécificité de l’habitat partagé réside dans la possibilité de mettre en commun les prestations issues de l’APA. Cette mutualisation, prévue par les textes, permet d’utiliser collectivement une partie des plans d’aide de chaque colocataire afin de financer des services partagés : présence d’un(e) accompagnant(e) 24h/24, aide au repas, activités, transports, etc.
L’intérêt est double :
1. Offrir un encadrement plus présent et plus qualitatif que si chaque personne vivait seule à domicile,
2. Maitriser les coûts en divisant certaines dépenses.
Cette logique de partage permet de concilier qualité de vie, lien social, et continuité de l’autonomie, tout en évitant le passage précoce en EHPAD.
Une démarche simple, dans le respect du choix individuel
La mutualisation n’est pas obligatoire : chaque bénéficiaire décide librement de l’utiliser ou non. Elle ne peut être mise en place qu’avec l’accord explicite de la personne concernée (ou de son représentant légal). Elle est réversible à tout moment.
Concrètement, la personne (ou ses proches) en fait la demande au moment de l’évaluation par l’équipe APA du département, qui valide ensuite les modalités de mise en commun.
Un modèle d’avenir
Dans un contexte où les places en EHPAD sont limitées et où la demande pour des alternatives plus humaines et souples progresse, l’habitat partagé, associé à l’APA, incarne une solution à la fois solidaire, économique et respectueuse des choix de vie.
Il s’inscrit pleinement dans les objectifs des politiques publiques en faveur du maintien à domicile, en facilitant l’accès à un accompagnement de qualité, adapté à chaque situation.
L’APA et l’habitat partagé, loin d’être incompatibles, forment un duo efficace pour répondre aux défis du vieillissement. En permettant à des personnes en perte d’autonomie de vivre ensemble, de mutualiser certaines aides et de conserver leur cadre de vie, cette alliance préfigure une nouvelle façon d’accompagner la vieillesse : plus humaine, plus adaptée, et plus digne.
Pour toute question sur la mise en place de l’APA en habitat partagé, les équipes de « Comme à la Maison » par Maisons de Famille peuvent accompagner les familles et futurs résidents dans leurs démarches.


